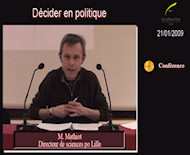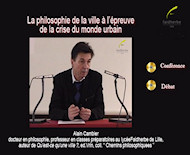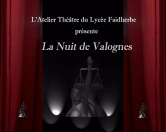SOMMAIRE
Le Levant contemporain.
H.
Laurens (20-01-10)
Décider en politique.
P.
Mathiot (21-01-09)
La philosophie
de la ville ...
A. Cambier (07-01-09)
Qui a peur de Charles
Darwin ?
A. Prochiantz, T. Lepeltier, M. Raymond
et N.
Witkowski (18-11-08)
La révolution iranienne
de 1979
Yann Richard (14-11-08)
Le règne d'Élisabeth
1ère
Bernartd Cottret (26-03-08)
L'indentité allemande
Étienne
François (12-03-08)
Récital du Duo Damier
Anne-Elly
Tévi & N. Medvedeva
(24-10-07)
Les nouveaux supraconducteurs
Julien Bobroff
(09-10-07)
La justice en France aujourd'hui
Philippe
Lemaire (03-10-07)
La nuit de Valognes
Atelier
Théâtre du lycée Faidherbe
(28-09-07)
Huysmans, quel Huysmans ?
Emmanuel Godot (12-09-07)
L'acoustique de la voix chantée
Nathalie Henrich
(22-02-07)
Sous le patronage de Philippe Bauden et Michel Bouchaud, proviseurs,
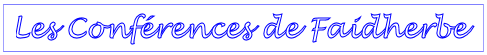
organisées avec le concours de l'ex-Foyer socio-éducatif du lycée
Cette page récapitule les extraits vidéo des conférences de Faidherbe.
Les conférences de Faidherbe ont été filmées par Valéry Bailly du CDRP Nord-Pas-de-Calais.
|
Le Levant des années 1880 à l'entre deux guerres.par Henry Laurens,
|
mercredi 20 janvier 2010 |
|
|
Décider en politiquepar Pierre Mathiot,
|
mercredi 21 janvier 2009
|
|
La décision politique est souvent présentée, par
les responsables politiques eux-mêmes ou par les journalistes,
comme un acte qui "va de soi" et qui a vocation
à régler "naturellement" un problème. Ce primat
rationaliste doit être interrogé. En effet, une observation
attentive de la manière dont l'action publique s'organise,
tant au plan national qu'au plan local, montre que la
décision est souvent prise de manière rapide et réactive
sans évaluation réelle des problèmes posés. |
La philosophie de la ville à l'épreuve de la crise du monde urbainpar Alain Cambier,
|
mercredi 7 janvier 2009
|
|
Parler de crise du monde urbain peut sembler
paradoxal, car |
Qui a peur de Charles Darwin ?par
|
mardi 18 novembre 2008
|
|
En collaboration avec "Citéphilo" et à l'occasio du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin ainsi que du 150e anniversaire de la publication de son œuvre «L'origine des espèces», les conférenciers cherchent à faire comprendre la théorie de l'évolution et expliquent comment cette théorie du vivant a pris tant d'importance au fil du temps. |
La RÉVOLUTION IRANIENNE de 1979, un évènement historiquepar Yann Richard,
|
vendredi 14 novembre 2008 |
|
Pourquoi le régime de Téhéran fait-il trembler l'Occident depuis un quart de siècle ? Comment est née cette république islamique dont dépend aujourd'hui la paix au Moyen-Orient ? Yann Richard explique la radicalisation de ce pays où le clergé a joué un rôle politique bien avant l'ère de Khomeyni. Un nationalisme particulier, car inséparable de la religion, s'y est développé dès le XIXe siècle, en réaction contre des souverains autocrates qui vendaient les richesses du pays aux Russes et aux Britanniques. Une première révolution, en 1906, a doté l'Iran d'une monarchie de type parlementaire. Soixante-dix ans plus tard, la révolution qui a renversé le Shah, après une politique de laïcisation mal acceptée, a été menée par les mollâhs associés à des intellectuels libéraux et à des partis de gauche. Derrière le rideau de l'islam militant, les cortèges révolutionnaires réclamant l'indépendance et la liberté dénonçaient autant l'absolutisme du Shah que l'impérialisme de Washington. La ferveur idéologique est aujourd'hui retombée, mais Téhéran veut plus que jamais jouer un rôle régional. Et les Iraniens vivent comme une revanche sur un siècle de domination étrangère et sur leur tragique isolement pendant la guerre contre l'Irak leur ambitieux programme nucléaire. |
Le RÈGNE d'ÉLISABETH 1ère : religion, patriotisme et sphère privée en Angleterre, 1558-1603par Bernard Cottret,
|
mercredi 26 mars 2008 |
|
Au nombre des sujets abordés par Bernard
Cottret, les liens toujours complexes entre la religion
et la conscience nationale. |
Une NOUVELLE IDENTITÉ ALLEMANDE ?par Étienne François,
|
mercredi 12 mars 2008 |
|
Cette conférence s'inscrit dans un cycle sur les questions d’identité dans une perspective comparative alors que cette question anime les débats politiques en France ; pour la France, l’immigration prend une grande ampleur à la fin du 19e siècle ; pour l’Allemagne, il s’agit d’une tendance sensible à partir des années 1960. Étienne François, qui réside à Berlin depuis fort longtemps, intervient sur la mémoire allemande, la place qu'occupe ce pays dans le monde et plus particulèrement en Europe. |
Les NOUVEAUX SUPRACONDUCTEURSpar Julien Bobroff,
professeur des universités
|
mardi 9 octobre 2007 |
|
Cette conférence se déroule le jour même où la fameuse
académie suédoise attribue le prix
Nobel de Physique à Albert
Fert qui entreprit ses travaux sur la magnétorésistance
géante (GMR) dans le laboratoire de Physique
des Solides d'Orsay auquel appartient Julien Bobroff. |
La JUSTICE en FRANCE AUJOURD'HUIpar Philippe Lemaire, procureur de la République |
mercredi 3 octobre 2007 |
|
La justice en 2007 : les enjeux judiciaires
contemporains. |
La NUIT de VALOGNESpar l'Atelier Théâtre du Lycée
Faidherbe
|
vendredi 28 septembre 2007 |
|
Quatre femmes arrivent dans un château délabré.
Ce sont d'anciennes victimes de Don Juan convoquées
par la Duchesse de Vaubricourt pour faire le procès
du séducteur. Pour châtiment, il devra épouser sa dernière
victime, Angélique, filleule de la Duchesse. |
HUYSMANS, quel HUYSMANS ?par Emmanuel Godo, professeur en classes préparatoires. |
mercredi 12 septembre 2007 |
|
On distingue couramment trois périodes dans l'œuvre de Joris-Karl Huysmans (1848-1907). La première met en scène un compagnon de route de Zola, peintre naturaliste des misères de la vie moderne, de Marthe, histoire d’une fille (1876) à A Vau-l’eau (1882). La deuxième présente un décadent, auteur d’un roman culte, bréviaire du dilettantisme fin de siècle, A rebours (1884) dont le héros, des Esseintes, est le dandy par excellence, maître ès déliquescences et raffinements interlopes. La troisième période est centrée autour d’un écrivain catholique, converti dans et par la douleur, auteur de romans monstres, réputés illisibles comme La Cathédrale (1898). Comment ces trois « personnages » tiennent-ils ensemble ? Par quelle obscure nécessité sont-ils liés ? N’y aurait-il pas qu’un Huysmans qui, à travers ses différents avatars n’en finit pas de se chercher ? |
L'ACOUSTIQUE de la VOIX CHANTÉEpar Nathalie HENRICH,
chargée de recherches au C.N.R.S.
|
jeudi 22 février 2007 |
|
Dans la tradition des acousticiens français Emile
Leipp et Michèle
Castellengo, Nathalie
Henrich expose les méthodes et recherches de l'Acoustique
musicale moderne appliquées à un instrument bien particulier
: la voix. |
|
|